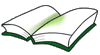| Résumé : |
Si la médiatisation accrue du Trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) permet une meilleure reconnaissance des difficultés vécues par les personnes concernées, elle soulève des défis majeurs en termes d’accès au diagnostic et aux soins.
Longtemps, le Trouble déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) a été considéré comme spécifique à l’enfance et à l’adolescence. Les premières descriptions cliniques mettaient l’accent sur l’hyperactivité comme symptôme prédominant, ce qui a conduit à qualifier ce trouble d’« hyperkinétique » par exemple dans la Classification internationale des maladies de l’Organisation mondiale de la santé, version 10 (OMS) (CIM-10). Ce focus menait également à une identification surtout chez des garçons en âge scolaire. Ce n’est que dans la seconde moitié du XXe siècle que la composante attentionnelle a été mise au centre, mais le trouble est resté longtemps diagnostiqué uniquement chez l’enfant et l’adolescent. Or, depuis les années 1970, et sous l’impulsion de psychiatres américains comme Wender, on a observé que certains symptômes pouvaient persister après l’adolescence, et même à un âge plus avancé. Un nombre croissant d’études épidémiologiques et de suivi d’enfants diagnostiqués est ainsi venu confirmer ces observations cliniques. Les symptômes persistent en effet à l’âge adulte chez 85 % des enfants diagnostiqués (Biederman et al., 1996).
Depuis, le TDAH est entré dans le champ des troubles neurodéveloppementaux et conceptualisé comme un pattern particulier du fonctionnement cérébral. |