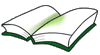Souffrance, bien-être et normalité |
Dépouillements

 Ajouter le résultat dans votre panier
Ajouter le résultat dans votre panier
Titre : Médecine physique et de réadaptation : entre bienfaisance normative et éthique de la compréhension Type de document : texte imprimé Auteurs : R. Gil, Auteur Année de publication : 2022 Article en page(s) : p. 62-67 Langues : Français (fre) Mots-clés : médecine physique et de réadaptation éthique du care bienfaisance normative éthique de la compréhension Résumé : La médecine physique et de réadaptation (MPR), plutôt désignée sous le terme de médecine physique et de réhabilitation dans le monde anglo-saxon, est d’abord fondée sur le principe de bienfaisance. Mais la bienfaisance est en quelque sorte confondue avec une visée : celle d’un retour aux normes. Mais le bien-être est-il toujours un retour à la normale ? Comment concilier la bienfaisance avec une éthique de la compréhension ? La société n’a-t-elle pas aussi le devoir de s’adapter aux personnes handicapées, blessées, malades ? Une éthique du care fondée sur l’empathie doit aussi prendre en compte les compromis existentiels élaborés par les personnes victimes de troubles moteurs, sensoriels ou neuropsychologiques qui ont bouleversé leur vie : telle est la condition de la prise en compte de leur autonomie donc de leur dignité humaine. Cycle : Généralités Permalink : http://www.galileonet.be/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=124713
in Ethique & Santé > Vol. 19, n°2 (juin 2022) . - p. 62-67[article]Une contribution philosophique ? la stigmatisation / J. Quintin in Ethique & Santé, Vol. 19, n°2 (juin 2022)
Titre : Une contribution philosophique ? la stigmatisation : d'un jugement moral ? un autre Type de document : texte imprimé Auteurs : J. Quintin, Auteur Année de publication : 2022 Article en page(s) : p. 68-75 Langues : Français (fre) Catégories : [MeSH] Santé mentale
[RAMEAU] Stigmatisation (psychologie sociale)Mots-clés : normativité normalité subjectivation Résumé : La stigmatisation existe depuis l’antiquité. Il n’en demeure pas moins qu’elle persiste encore aujourd’hui et apporte son lot de conséquences négatives. Les aspects structuraux, interpersonnels et intrapersonnels s’entrecroisent et affectent la vie de plusieurs personnes en termes d’accès aux soins, de rétablissement et de qualité de vie. Même si la réduction et la prévention de la stigmatisation furent une priorité pour les chercheurs et les intervenants du milieu au moyen de campagne de sensibilisation, les résultats demeurent mitigés. S’il est difficile d’expliquer un tel échec, nous pensons que la philosophie peut être utile pour explorer d’autres possibilités. Nous introduirons une perspective philosophique selon la pensée de Georges Canguilhem et de Judith Butler afin d’aborder autrement la stigmatisation. Pour conclure, nous pensons qu’il devient nécessaire d’introduire de nouvelles manières de pratiquer la médecine, la psychiatrie, la psychologie et la sociologie en évitant le piège de la logique binaire du tiers exclu et en élargissant le spectre des possibilités. Promouvoir la subjectivation peut devenir une manière d’aider les personnes à comprendre leur maladie comme une réalité qui favorise le changement et la créativité. Cycle : Généralités Permalink : http://www.galileonet.be/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=124714
in Ethique & Santé > Vol. 19, n°2 (juin 2022) . - p. 68-75[article]Trouble psychiatrique, souffrance réfractaire et aide active ? mourir / J. Vachon in Ethique & Santé, Vol. 19, n°2 (juin 2022)
Titre : Trouble psychiatrique, souffrance réfractaire et aide active ? mourir Type de document : texte imprimé Auteurs : J. Vachon, Auteur Année de publication : 2022 Article en page(s) : p. 76-83 Langues : Français (fre) Catégories : [MeSH] Dépression
[MeSH] Disciplines et professions:Professions de santé:Médecine:Psychiatrie
[MeSH] Ethique
[MeSH] Euthanasie
[MeSH] Soins aux patients:Soins terminaux:Suicide assistéRésumé : Les différentes possibilités d’aide active à mourir sont des pratiques à l’origine de nombreuses controverses dont l’autorisation génère des situations complexes à appréhender. C’est notamment le cas lorsque la souffrance à l’origine de la requête d’un individu est en lien avec un trouble psychiatrique. De ce fait, dans des pays tels que la Belgique ou les Pays-Bas, où cette pratique est autorisée, de nombreuses incertitudes subsistent quant à la démarche qu’il est approprié d’adopter afin de garantir l’assistance individuelle d’une part et le respect de l’autonomie d’autre part. Effectivement, il est particulièrement complexe d’établir de manière incontestable la recevabilité d’une demande. La sévérité de la souffrance, son caractère insupportable et réfractaire, la réalité de la capacité décisionnelle de la personne ne bénéficient pas d’outils de mesure fiables. De plus, au-delà de la requête de l’individu, c’est également l’implication des soignants et l’intégration de ce type de procédure à la pratique médicale qui interroge. Ces éléments exposent ainsi la nature plurielle des questionnements soulevés par cette possibilité, intéressant à la fois le sens de la souffrance mais aussi celui du soin. Cet article discute de l’admissibilité, d’un point de vue éthique, du recours à l’aide active à mourir dans l’accompagnement d’un individu affecté par un trouble psychiatrique sévère, marquée par un désir de mort et réfractaire aux traitements bien conduits, qui en exprime le souhait. Cycle : Généralités Permalink : http://www.galileonet.be/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=124715
in Ethique & Santé > Vol. 19, n°2 (juin 2022) . - p. 76-83[article]Judiciarisation de la fin de vie en réanimation / M. Le Dorze in Ethique & Santé, Vol. 19, n°2 (juin 2022)
Titre : Judiciarisation de la fin de vie en réanimation : quand les proches demandent la poursuite des traitements Type de document : texte imprimé Auteurs : M. Le Dorze, Auteur Année de publication : 2022 Article en page(s) : p. 84-89 Langues : Français (fre) Catégories : [MeSH] Accompagnement de la fin de la vie
[MeSH] Législation comme sujet:Législation et jurisprudenceMots-clés : Judiciarisation limitation et arrêt des thérapeutiques obstination déraisonnable Résumé : Les décisions de limitation ou d’arrêt des thérapeutiques, prises au titre du refus de l’obstination déraisonnable, dans le cadre de la loi Claeys–Leonetti, sont de plus en plus fréquentes en réanimation. Lorsque les proches du patient sont en désaccord avec ces décisions, des conflits peuvent naître et conduire à une judiciarisation de la fin de vie. Cet article propose d’explorer ces situations à partir d’une histoire clinique singulière. Les repères juridiques utiles aux soignants sont précisés, en particulier le recours sous forme de référé-liberté. La décision judiciaire ne rencontre pas toujours la décision médicale. Au-delà des conséquences de ces conflits sur les soignants, leur dynamique est explorée pour mieux les prévenir. Finalement, l’impact de ces expériences conflictuelles et de la jurisprudence sur la place des proches dans la caractérisation de l’obstination déraisonnable est discutée. Cycle : Généralités Permalink : http://www.galileonet.be/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=124716
in Ethique & Santé > Vol. 19, n°2 (juin 2022) . - p. 84-89[article]
Titre : Penser le lieu de vie malgré la Covid-19 : ce qu'habiter en Ehpad veut dire à l'aune d'une éthique de la socialité Type de document : texte imprimé Auteurs : C. Donnart, Auteur Année de publication : 2022 Article en page(s) : p. 90-96 Langues : Français (fre) Catégories : [MeSH] Covid-19
[MeSH] Ethique
[MeSH] Résidences pour personnes âgées
[MeSH] Sujet âgéMots-clés : vulnérabilité Résumé : La pandémie de COVID-19 a entraîné la mise en place d’un certain nombre de mesures sanitaires entrant dans le champ de la théorie dite « des circonstances exceptionnelles ». Dans ce contexte, nombre de questionnements éthiques se sont posés, de façon récurrente, aux professionnels des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad). Comment, en effet, protéger la vie de nos aînés tout en garantissant l’exercice de leurs droits et libertés ? Au-delà de l’exercice complexe de conciliation de la liberté et de la sécurité, répondre à l’exigence conséquentialiste attachée au principe de proportionnalité s’est imposé dans le traitement de la crise sanitaire. Afin d’introduire de la justice dans les politiques publiques, la recherche d’un équilibre, entre santé publique et « santé institutionnelle », a nécessité l’adoption d’un point de vue plus large, dont rend compte cette réflexion phénoménologique. Porter une lumière sur les conséquences du bouleversement institutionnel et psychosocial, vécu de confinements en déconfinements, implique en ce sens de prendre la mesure de la déchirure du tissu internarratif et du champ des capabilités brutalement réduit à peau de chagrin. L’éloignement des solidarités de proximité ou bien encore la fragilité ontologique sont mises en perspectives avec l’atteinte observée du chez soi à l’aune de l’état d’exception. Cycle : Généralités Permalink : http://www.galileonet.be/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=124717
in Ethique & Santé > Vol. 19, n°2 (juin 2022) . - p. 90-96[article]Le care pour rendre compte des formes d'engagement bénévole dans la lutte contre la maltraitance envers les aînés / M. Crevier in Ethique & Santé, Vol. 19, n°2 (juin 2022)
Titre : Le care pour rendre compte des formes d'engagement bénévole dans la lutte contre la maltraitance envers les aînés Type de document : texte imprimé Auteurs : M. Crevier, Auteur Année de publication : 2022 Article en page(s) : p. 97-104 Langues : Français (fre) Catégories : [MeSH] Bénévoles
[MeSH] Maltraitance des personnes âgéesRésumé : L’approche politique du care permet de rendre compte de pratiques qui constituent une réponse morale aux situations de vulnérabilité des individus. Le bénévolat, dans la lutte contre la maltraitance, représente une voie pertinente pour comprendre l’interdépendance et la reconnaissance, deux processus centraux des pratiques de care, dont les aînés, et les bénévoles font l’expérience. Cet article présente les résultats d’une étude qui a saisi en quoi le care peut permettre de comprendre l’action bénévole dans la lutte contre la maltraitance envers les aînés. S’appuyant sur la phénoménologie herméneutique, cette recherche qualitative a recueilli le point de vue de deux types d’acteurs, celui des bénévoles d’une part, et celui des coordonnateurs d’organismes dédiés à la lutte contre la maltraitance, d’autre part. L’analyse permet de dégager quatre formes différentes d’articulation entre interdépendance et reconnaissance, qui correspondent à des variations de l’engagement bénévole : (1) L’interdépendance citoyenne articulée à une reconnaissance matérielle, (2) l’interdépendance citoyenne fondée sur la visée de reconnaissance du statut professionnel antérieur, (3) l’interdépendance à distance associée à la recherche d’une reconnaissance matérielle, (4) l’interdépendance à distance marquée par la reconnaissance du statut professionnel passé. La prise en compte de ces idéaux-types est primordiale pour renouveler les pratiques de recrutement des bénévoles se voulant plus inclusives. Cycle : Généralités Permalink : http://www.galileonet.be/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=124718
in Ethique & Santé > Vol. 19, n°2 (juin 2022) . - p. 97-104[article]
|
[n° ou bulletin]
[n° ou bulletin]
|