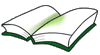Catégories


 Ajouter le résultat dans votre panier Affiner la recherche Interroger des sources externes
Ajouter le résultat dans votre panier Affiner la recherche Interroger des sources externesPratique d’une sédation proportionnée réversible à durée indéterminée / Marjory Olivier in Médecine palliative, Vol. 21, n°3 (mai 2022)
Titre : Pratique d’une sédation proportionnée réversible à durée indéterminée : Étude rétrospective de 9 cas à l’USP du CHU de Bordeaux Type de document : texte imprimé Auteurs : Marjory Olivier, Auteur ; Amandine Mathe, Auteur ; Thérèse Rivasseau Jonveaux, Auteur Année de publication : 2022 Article en page(s) : p. 115-125 Langues : Français (fre) Catégories : [MeSH] Anesthésie et analgésie:Sédation profonde
[MeSH] Malades en phase terminale
[MeSH] Soins aux patients:Soins palliatifsRésumé : En phase palliative terminale, différentes sédations peuvent être indiquées face à une situation dite réfractaire. Les sédations proportionnées, souvent peu profondes, réversibles et de durée indéterminée, se distinguent ainsi des sédations profondes et continues jusqu’au décès (SPMJD) instaurées par la Loi de Claeys-Leonetti. Cette étude rétrospective décrit les sédations proportionnées réalisées à l’unité de soins palliatifs du CHU de Bordeaux entre 2012 et 2017. Sur 850 dossiers aucune SPMJD n’est relevée et 9 cas de sédations réversibles et de durées indéterminées ont été identifiés. Les principaux symptômes réfractaires en cause étaient l’agitation (8 cas sur 9), l’épilepsie (souvent partielle), l’hypercalcémie maligne, l’embolie pulmonaire et les troubles psychiatriques. Les sédations par midazolam intra veineux ont été initiées en moyenne 7heures après la reconnaissance du caractère réfractaire des symptômes. Associées à un ajustement du traitement de fond dès la première heure, ces sédations ont permis le soulagement des 9 patients. Six récidives du symptôme initial sont survenues, entre 6 et 24heures après le début de la sédation. Toutes ont été soulagées par des prescriptions anticipées non sédatives ou une sédation complémentaire transitoire et proportionnée, dans 2 cas il n’a pas été nécessaire de la poursuivre. Tous les patients sont décédés, en moyenne 4jours après la sédation. Les éléments de procédures collégiales, d’évaluation de la vigilance et de modalités d’accompagnement de l’équipe étaient peu tracés dans les dossiers. La sédation proportionnée réversible lorsqu’elle est associée à une adaptation concomitante du traitement de fond est pertinente en cas de symptômes réfractaires en phase terminale. Elle favorise le maintien d’une communication avec l’entourage familial et les soignants ainsi que l’évaluation de la souffrance, notamment psychique et existentielle. Cycle : Généralités Permalink : http://www.galileonet.be/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=124635
in Médecine palliative > Vol. 21, n°3 (mai 2022) . - p. 115-125[article]Prise en charge palliative des détenus, étude au sein des unités hospitalières de soins interrégionales / Pierre-Marie Doumeizel in Médecine palliative, Vol. 21, n°5 (septembre 2022)
Titre : Prise en charge palliative des détenus, étude au sein des unités hospitalières de soins interrégionales Type de document : texte imprimé Auteurs : Pierre-Marie Doumeizel, Auteur Année de publication : 2022 Article en page(s) : p. 273-276 Langues : Français (fre) Catégories : [MeSH] Accompagnement de la fin de la vie
[MeSH] France
[MeSH] Malades en phase terminale
[MeSH] Prisonniers
[MeSH] Prisons
[MeSH] Soins aux patients:Soins palliatifs
[MeSH] Soins aux patients:Soins terminauxRésumé : En France, les prises en charges palliatives des détenus sont réalisées en majorité sous écrous. Un décès sous écrous reste un échec pour les soignants et les surveillants. Un questionnaire, délivré aux différentes unité hospitalière de soins interrégionale (UHSI), est réalisé afin de décrire les différentes situations palliatives ainsi que les difficultés rencontrées. Celui-ci objective des décès en UHSI, chez des patients où, dans la majorité des cas, une mesure de suspension de peine était envisageable. Il est décrit des difficultés pour la prise en charge palliative en centre pénitentiaire et en UHSI. Les mesures de suspensions de peines semblent être la solution depuis 2002 mais l’un des freins principaux est le temps de décision du juge d’application des peines (JAP). Il est important d’orienter les futures mesures afin d’adapter au mieux ses prises en charge déjà complexes. Cycle : Généralités Permalink : http://www.galileonet.be/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=126269
in Médecine palliative > Vol. 21, n°5 (septembre 2022) . - p. 273-276[article]La prise de décision anesthésique pour des patients en soins palliatifs : prendre ou ne pas prendre un risque per et péri-opératoire / Isabelle Strubi in Médecine palliative, Vol. 21, n°5 (septembre 2022)
Titre : La prise de décision anesthésique pour des patients en soins palliatifs : prendre ou ne pas prendre un risque per et péri-opératoire Type de document : texte imprimé Auteurs : Isabelle Strubi, Auteur Année de publication : 2022 Article en page(s) : p. 283-287 Langues : Français (fre) Catégories : [MeSH] Anesthésie et analgésie:Anesthésie
[MeSH] Appréciation des risques
[MeSH] Malades en phase terminale
[MeSH] Procédures
[MeSH] Sélection de patients
[MeSH] Soins aux patients:Soins palliatifsRésumé : Les patients en soins palliatifs, avec les limitations thérapeutiques qui leur sont attachés, peuvent ne pas accéder à des décisions chirurgicales en raison du risque anesthésique. A travers les cas cliniques de trois patients candidats à une intervention chirurgicale sous anesthésie générale, deux récusés sur le risque anesthésique et un accepté en salle opératoire, nous explorons les critères de prise de décision du risque anesthésique per et péri-opératoire et évoquons les différences de point de vue entre anesthésiste et médecin de soins palliatifs. Cette expérience éclaire notre compréhension des processus d’évaluation du risque anesthésique participant à la décision collégiale d’intervention chirurgicale, notre propre positionnement et volonté de soutenir les patients et leur famille au sein de cette décision. Cycle : Généralités Permalink : http://www.galileonet.be/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=126271
in Médecine palliative > Vol. 21, n°5 (septembre 2022) . - p. 283-287[article]